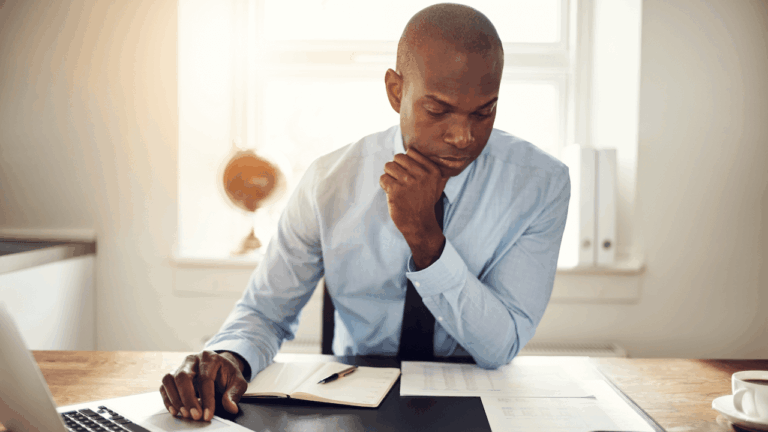Quand on parle de risques professionnels en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, on imagine souvent des secteurs comme la construction ou l’industrie. Les données officielles de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) permettent enfin d’y voir plus clair. Et le tableau est plus nuancé qu’on pourrait le croire.
Retour sur une année 2022 marquée par des tendances fortes, quelques surprises et des écarts notables selon les secteurs d’activité.
Un taux de fréquence parmi les plus bas des Drom
En 2022, 1 481 accidents du travail avec au moins une journée d’arrêt ont été reconnus en Guadeloupe*. Au total, cela représente 105 704 jours d’arrêt de travail.
Le taux de fréquence – c’est-à-dire le nombre d’accidents pour un million d’heures travaillées – s’établit à 8,4, un niveau inférieur :
- à la moyenne des autres Drom hors Mayotte (11,8)
- au niveau national (16,7)
Le territoire n’avait pas connu un taux aussi bas depuis 2010, période marquée par la crise économique mondiale et une forte crise sociale en Guadeloupe. Seule la Guyane affiche un taux plus faible (3,7).
Une évolution marquée par un pic en 2017
Sur le long terme, la tendance est assez irrégulière.
Entre 2005 et 2010, les accidents ont nettement diminué (de 1 391 à 931).
Ils repartent à la hausse ensuite, jusqu’à un pic exceptionnel en 2017 : 2 210 accidents, un record sur la période récente.
Depuis, le nombre oscille au-dessus de 1 500 AT par an. En 2020 et 2021, on comptait 1 710 et 1 903 accidents.
Les secteurs les plus exposés : agriculture et industrie en tête
Même si le commerce et les services concentrent mécaniquement 75 % des accidents (leur poids économique est énorme), ce ne sont pas les secteurs les plus dangereux proportionnellement.
Les secteurs les plus accidentogènes selon le taux de fréquence sont :
- agriculture : 15,7 accidents par million d’heures
- industrie : taux supérieur à la moyenne
- construction : 8,4, dans la moyenne mais avec une gravité bien supérieure
À l’inverse, les services restent les moins exposés (7,7).
La construction concentre les accidents les plus graves
La gravité est un autre indicateur essentiel. Et là, la construction se distingue très nettement :
- 11,4 % des accidents y entraînent une incapacité permanente
- Indice de gravité : 28,5, le plus élevé de tous les secteurs
- Taux moyen d’IPP : 29,9 %, un record en 2022
Les accidents y sont moins fréquents que dans l’agriculture, mais les séquelles y sont plus lourdes.
Hommes, femmes : des expositions différentes
Les hommes restent plus touchés :
- 8,9 accidents par million d’heures contre 7,8 pour les femmes
- indice de gravité plus élevé : 14,7 contre 4,8
- taux moyen d’IPP : 21,8 % pour les hommes, 8,6 % pour les femmes
La différence tient surtout aux métiers occupés : construction, manœuvres, activités physiques plus exposées.
L’âge ne change pas vraiment la fréquence, mais augmente la gravité
Le taux de fréquence varie peu selon l’âge. La gravité, en revanche, augmente nettement avec les années, surtout pour les 40-49 ans où le taux moyen d’IPP atteint son maximum. Les accidents chez les moins de 20 ans restent rares et statistiquement peu significatifs.
Saint-Martin : un taux de fréquence plus faible, mais des séquelles plus fréquentes
À Saint-Martin, 70 accidents du travail ont été reconnus en 2022. Le taux de fréquence y est plus faible qu’en Guadeloupe (5,9 contre 8,5).
Un accident sur douze entraîne toutefois une incapacité permanente, soit une proportion légèrement supérieure à celle de la Guadeloupe seule (un sur treize). Les hommes restent les plus touchés (60 % des accidents).
Ce qu’il faut retenir
L’année 2022 confirme plusieurs tendances de fond :
- la Guadeloupe affiche des taux d’accidents du travail plus faibles que la moyenne nationale
- l’agriculture, l’industrie et la construction restent les secteurs à risque
- la construction concentre les accidents les plus graves
- les hommes et les salariés d’âge intermédiaire sont les plus exposés
- le tertiaire génère la majorité des accidents en volume, simplement parce qu’il représente l’essentiel de l’économie
À travers ces données, on voit aussi les efforts engagés par les entreprises, les travailleurs et les institutions pour réduire les risques. Et même si le niveau global est plutôt bas, les disparités sectorielles rappellent l’importance de maintenir la prévention au cœur de la vie professionnelle.