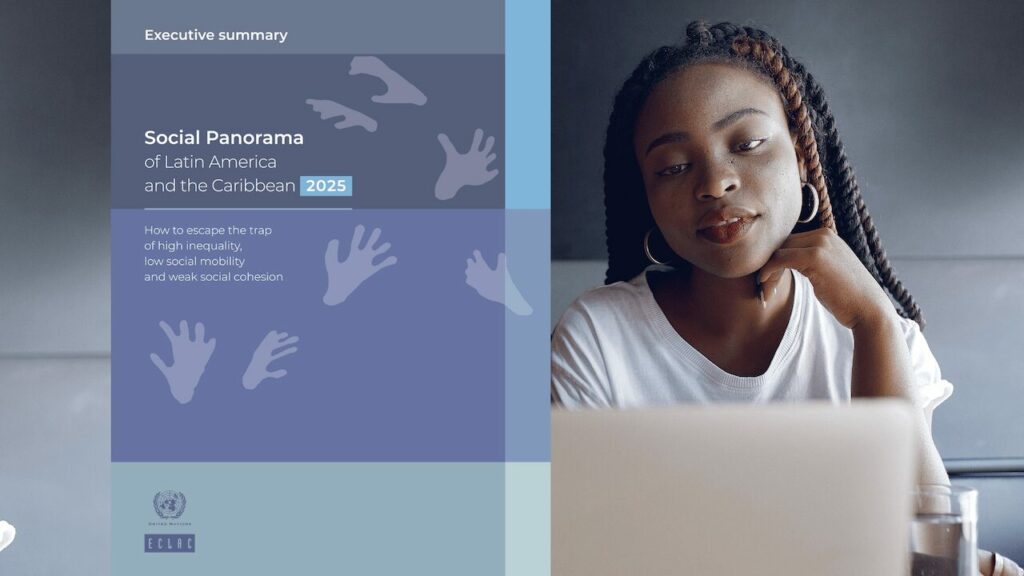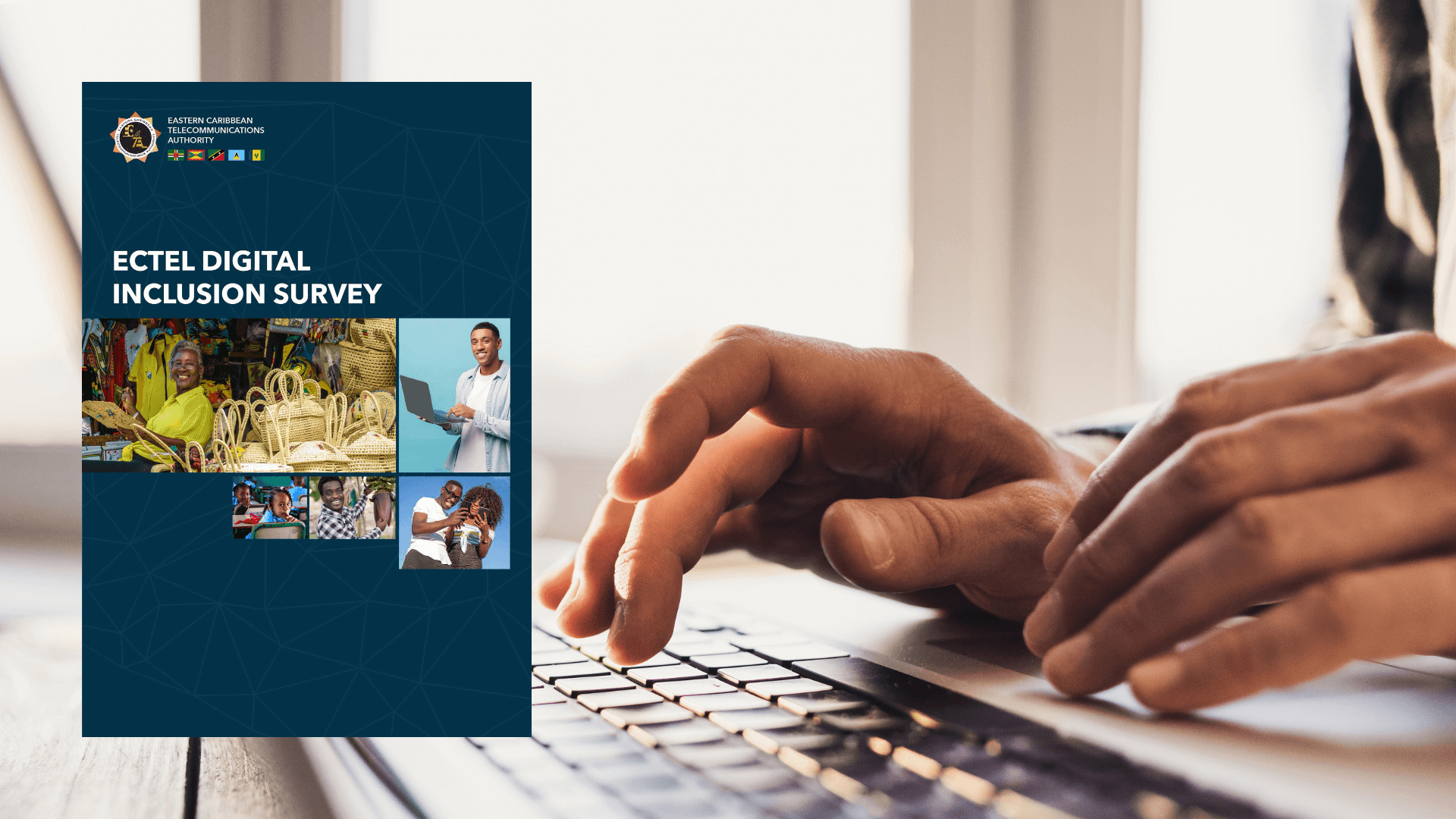J’ai parcouru le dernier rapport de la (Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), Social Panorama of Latin America and the Caribbean 2025, sorti aujourd’hui.
Ce rapport est dense, mais il livre un tableau clair : la région reste enfermée dans la trappe de l’inégalité, malgré quelques signes d’amélioration.
Une région toujours marquée par une inégalité structurelle
La CEPALC rappelle que l’Amérique latine et la Caraïbe affrontent trois grands blocages : faible croissance, institutions fragiles et inégalités persistantes. Cette dernière est la plus lourde. Elle affaiblit la mobilité sociale, limite les opportunités et fragilise la cohésion démocratique.
Les dernières données sont sans appel : les 10 % les plus riches captent 34,2 % du revenu total de la région. Le niveau d’inégalité y reste l’un des plus élevés au monde, juste derrière l’Afrique subsaharienne.
Une baisse légère, insuffisante pour changer la donne
Le rapport observe un frémissement positif : le coefficient de Gini a légèrement baissé, passant de 0,469 en 2021 à 0,452 en 2024. Ce n’est pas négligeable, mais les causes ne sont pas celles qu’on espère. Ce sont :
- les dynamiques du marché du travail,
- la réduction de la taille des ménages, surtout parmi les plus pauvres.
Les politiques publiques n’ont pas été le moteur de cette amélioration. On ne peut donc pas parler de transformation structurelle.
Une réduction importante de la pauvreté en 2024
L’année 2024 marque un tournant, avec des reculs historiques de la pauvreté :
- 25,5 % de pauvres, contre 32,7 % en 2020 ;
- 9,8 % d’extrême pauvreté, encore au-dessus du niveau de 2014, mais en baisse.
Il faut toutefois noter que le Mexique et le Brésil expliquent à eux seuls la majorité de cette baisse. Sans eux, les niveaux seraient proches de ceux de 2019.
La pauvreté multidimensionnelle, qui analyse des dimensions comme l’emploi, le logement, l’éducation ou la santé, atteint 20,9 %, un chiffre en baisse constante malgré la parenthèse de la pandémie.
Les privations les plus lourdes concernent :
- l’emploi et les retraites,
- la qualité du logement,
- l’accès à Internet.
L’éducation, grande faille du développement
Même si la scolarisation a progressé, l’éducation reste l’un des plus grands facteurs d’inégalité. Le rapport rappelle plusieurs réalités :
- Les élèves de 15 ans de la région obtiennent des scores 48 points plus faibles que la moyenne OCDE en mathématiques.
- Les jeunes des familles pauvres restent massivement exposés au décrochage.
- Les systèmes éducatifs ne parviennent pas à corriger les inégalités d’origine.
La CEPALC recommande :
- de généraliser l’accès à l’éducation pré-primaire,
- de sécuriser les parcours du secondaire,
- d’améliorer la qualité pédagogique par des méthodes adaptées et des investissements ciblés.
Le constat est clair : pas de mobilité sociale sans une école solide.
Des marchés du travail profondément inégaux
La région reste dominée par un marché du travail segmenté et très informel. La moitié des travailleurs sont dans l’informel, surtout :
- les femmes,
- les jeunes,
- les Afrodescendants,
- les populations autochtones,
- les travailleurs des secteurs peu qualifiés.
Le rapport montre un chiffre impressionnant : si tous les travailleurs informels devenaient formels, leurs revenus augmenteraient en moyenne de 29 %. Cela réduirait la pauvreté et ferait baisser le Gini de manière significative.
Les inégalités de genre restent écrasantes
Les données sont frappantes :
- L’indice de féminité de la pauvreté atteint 121, confirmant que les femmes restent les plus touchées.
- Elles réalisent la majorité du travail domestique non rémunéré, qui représente entre 19 et 27 % du PIB selon les pays.
- Les unions précoces restent très présentes dans les milieux les plus pauvres.
- Les femmes sont massivement sous-représentées dans les filières STEM et sur les postes de décision.
Le rapport va plus loin : il rappelle que la transition vers une société du care, centrée sur la reconnaissance et le partage des tâches de soin, est essentielle au développement humain et économique de la région.
Autochtones, migrants, personnes en situation de handicap : des exclusions cumulées
La CEPALC dresse un état des lieux sans détour :
- Les populations autochtones restent confrontées à des carences chroniques dans les territoires où elles vivent, notamment en matière d’éducation supérieure et d’accès aux services publics.
- Les migrants, même lorsqu’ils ont un niveau d’éducation supérieur à celui des natifs, sont plus souvent cantonnés à l’informel.
- Les personnes en situation de handicap ont des taux de participation au travail souvent inférieurs à 30 %.
Ces inégalités ne sont pas des accidents. Elles sont le résultat de discriminations multiples, anciennes, profondément ancrées.
Des institutions trop fragiles pour inverser la tendance
Le rapport insiste sur un autre point : même lorsque les États adoptent des politiques sociales ambitieuses, leurs capacités institutionnelles restent limitées. Faible coordination, manque de financement, instabilité politique… autant d’éléments qui freinent la mise en œuvre effective des politiques publiques.
Après le pic exceptionnel de 2020, les dépenses sociales ont reflué et se stabilisent désormais autour de 11,6 % du PIB en moyenne.
Un appel à un pacte pour le développement social inclusif
La CEPALC plaide pour un véritable pacte régional, articulé autour de dix priorités, dont :
- éradiquer la pauvreté,
- réduire les inégalités,
- investir massivement dans l’éducation,
- renforcer la protection sociale,
- améliorer la qualité de l’emploi,
- intégrer pleinement les femmes, les jeunes, les migrants, les personnes handicapées et les populations autochtones,
- construire des institutions plus solides et plus efficaces.
Parce que tant que la région restera enfermée dans la trappe de l’inégalité, aucun modèle de développement durable ne pourra émerger.