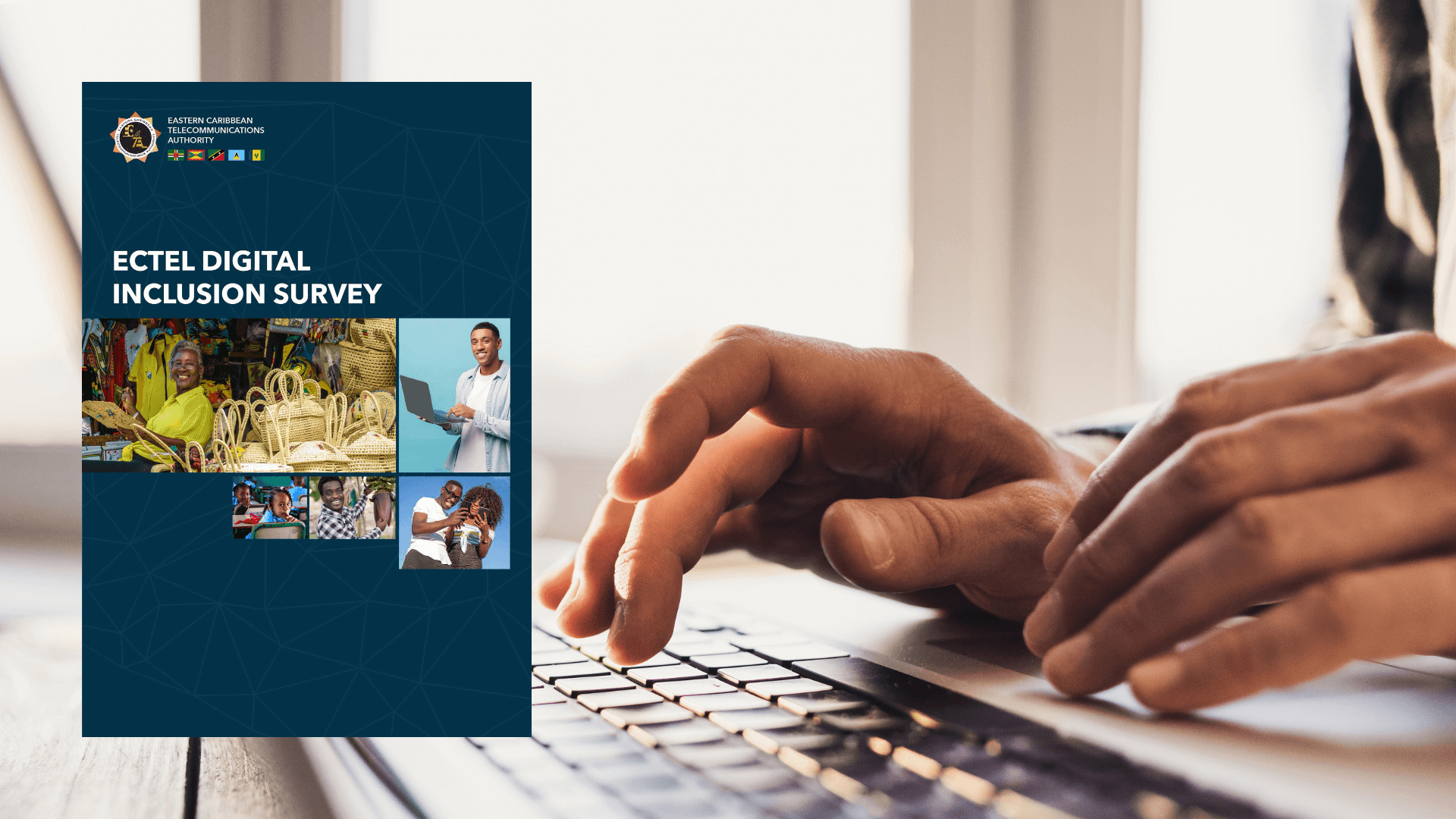Le Sommet des Amériques, qui devait se tenir du 1er au 6 décembre 2025 à Punta Cana en République dominicaine, a été reporté à 2026. L’annonce officielle évoque des « divergences profondes » et un « contexte régional tendu ». En réalité, ce report révèle à quel point la situation politique, militaire et diplomatique dans la Grande Caraïbe est devenue instable.
Un sommet prévu pour rassembler… et désormais suspendu
Ce rendez-vous devait réunir l’ensemble des chefs d’État et de gouvernement du continent américain autour d’un thème central : « Construire un hémisphère sûr et durable avec prospérité partagée ».
Le programme préparatoire insistait sur quatre priorités : la sécurité des citoyens, l’énergie, l’alimentation et l’eau — des sujets essentiels pour la région caribéenne, particulièrement exposée aux crises climatiques et économiques.
Pourtant, malgré l’ambition affichée, le sommet a été stoppé net. Le gouvernement dominicain, pays hôte, a annoncé le report « avec l’accord de Washington », estimant qu’un dialogue apaisé n’était plus possible dans le contexte actuel.
Une région sous tension
Depuis plusieurs semaines, les signaux d’alerte se multiplient. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la mer des Caraïbes, officiellement pour contrer le narcotrafic. Des navires et avions de chasse F-35 ont été déployés dans la zone. Cette démonstration de force a aussitôt provoqué la colère de Caracas, La Havane et Bogotá, qui y voient une tentative d’intimidation. La tension s’est encore accentuée après l’annonce de l’exclusion de Cuba, le Nicaragua et le Venezuela du sommet. Un choix perçu comme une décision politique, qui fracture encore davantage le continent.
En parallèle, plusieurs pays caribéens peinent à se relever du passage de l’ouragan Melissa, qui a dévasté une partie de leurs infrastructures en octobre. L’atmosphère n’était donc pas à la coopération sereine, ni aux grandes déclarations multilatérales.
Une mauvaise nouvelle pour les îles caribéennes
Ce report n’est pas anodin. Il prive les petits États de la Caraïbe d’une occasion de porter leurs priorités sur la scène continentale : la sécurité alimentaire, la résilience face aux catastrophes, la transition énergétique et la gouvernance maritime.
Le Sommet des Amériques, malgré ses limites, reste l’un des rares espaces où les leaders des grandes puissances et ceux des petites îles peuvent dialoguer directement.
En gelant le processus, les États-Unis et leurs alliés laissent planer le doute sur la place réelle accordée aux territoires caribéens dans l’agenda hémisphérique.
Et maintenant ?
Aucune nouvelle date n’a été fixée. L’Organisation des États américains (OEA) évoque un report « à 2026 ». D’ici là, la diplomatie régionale risque de se jouer ailleurs : lors des rencontres de la CARICOM, de la CELAC ou dans les dialogues bilatéraux entre pays caribéens et latino-américains.
Pour la Caraïbe, cette séquence est révélatrice : l’équilibre géopolitique reste fragile, les intérêts des grandes puissances toujours dominants, et la voix des îles — encore trop souvent marginalisée — doit trouver de nouveaux espaces pour se faire entendre.