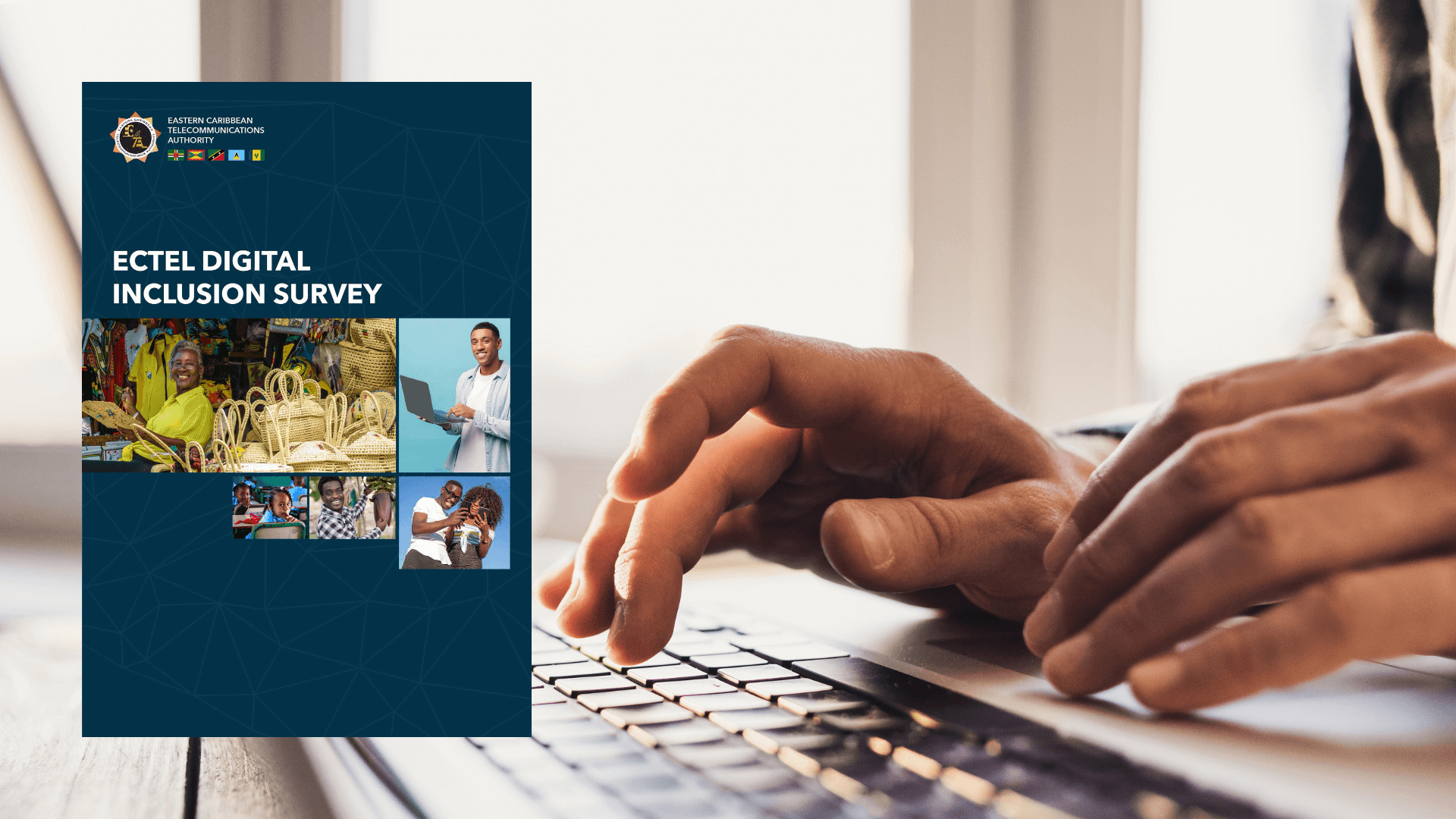Depuis plus de vingt ans, Google règne sur le web mondial. Un clic, une réponse. Une requête, un résultat. Cependant, dans la Grande Caraïbe, cette domination a un prix : celui de l’invisibilité. Derrière la facilité d’usage se cache un déséquilibre profond qui affaiblit nos médias, nos langues et notre économie numérique.
L’ombre d’un géant sur un petit écosystème
La Caraïbe produit énormément de contenus, d’images, de savoirs, de récits. Pourtant, la plupart ne franchissent jamais les premières pages du moteur de recherche. Les algorithmes de Google favorisent les sites puissants, bien référencés et abondamment reliés entre eux. Or, les portails caribéens sont souvent modestes, isolés, et manquent de moyens techniques pour rivaliser. Résultat : quand on cherche « gastronomie caribéenne », « musique antillaise » ou « écrivains haïtiens », ce sont souvent des médias américains, français ou britanniques qui apparaissent avant les acteurs locaux. Le web caribéen est là, mais Google ne le voit pas.
Une économie de la dépendance
Chaque campagne publicitaire lancée via Google Ads, chaque vidéo monétisée sur YouTube, chaque clic sur AdSense enrichit les serveurs de Mountain View. Les entreprises caribéennes investissent, mais les revenus repartent ailleurs. C’est une fuite de valeur à grande échelle.
Pendant ce temps, les médias locaux peinent à rentabiliser leur audience et les créateurs de contenus reçoivent des rémunérations dérisoires, faute de volumes jugés suffisants.
Dans cette économie numérique mondialisée, la Caraïbe est un marché, pas un acteur.
Uniformisation culturelle et effacement linguistique
L’algorithme de Google aime ce qui plaît au plus grand nombre. Les langues minoritaires, les expressions créoles, les références locales sont peu indexées, mal traduites, souvent considérées comme des « anomalies ». Peu à peu, nos internautes consomment les mêmes contenus standardisés que partout ailleurs, tandis que les productions ancrées dans nos territoires deviennent invisibles.
C’est une forme de colonialisme numérique, douce mais redoutable : la diversité s’efface au profit d’une culture globale aseptisée.
La question de la souveraineté numérique
Tout ou presque passe par Google : les mails, les cartes, les vidéos, les outils éducatifs. Cette centralisation a créé une dépendance massive. Si demain, Google décidait de restreindre certains services ou d’en modifier les conditions, des écoles, administrations et entreprises caribéennes entières seraient paralysées. Et les données issues de nos usages — itinéraires, recherches, habitudes — alimentent des algorithmes dont la région ne tire aucun bénéfice. Nous avons offert nos données, sans jamais construire nos défenses.
Il ne s’agit pas de diaboliser Google, mais de regarder lucidement le rapport de force.
Google ne détruit pas la Caraïbe. Il l’ignore. Cc’est cette indifférence algorithmique, silencieuse et constante, qui érode peu à peu notre visibilité, notre économie et notre identité numérique.