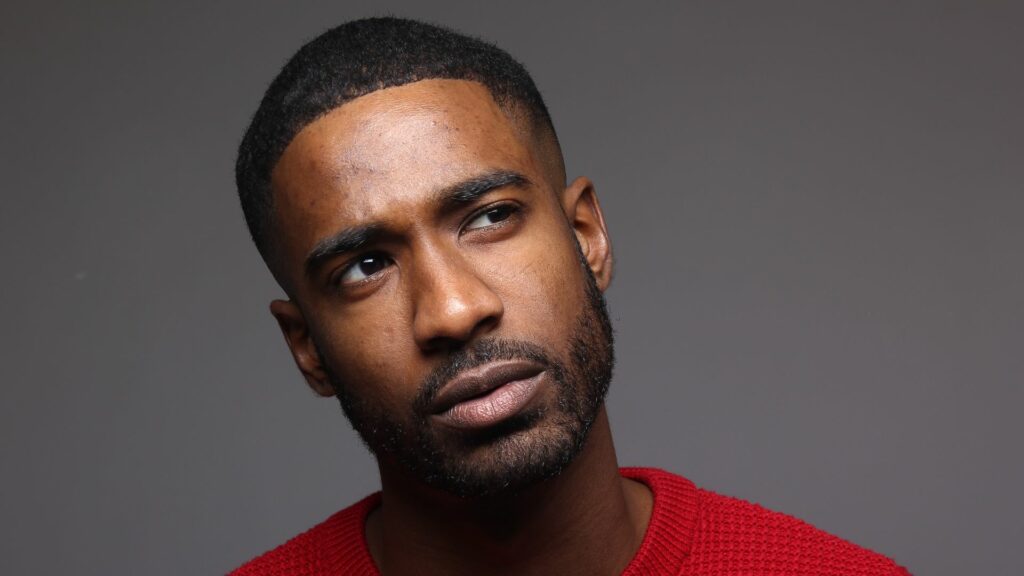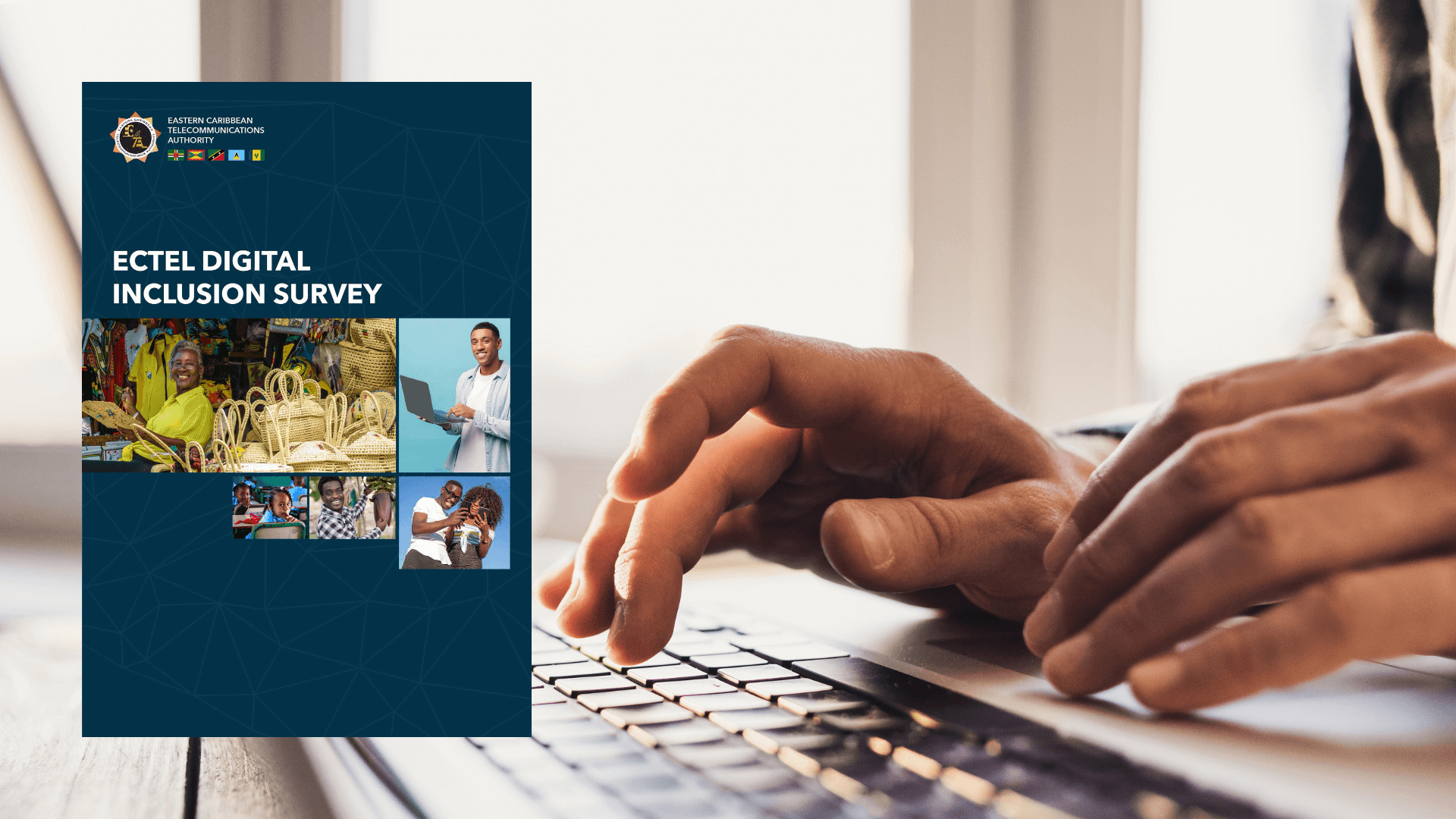Si vous lisez ce blog régulièrement, vous aurez noté que je suis très friande de statistiques sur notre région. Je lis régulièrement des études en français et en anglais, et j’essaye de plus en plus de partager les chiffres clés dans des billets de blog.
Cependant, j’ai depuis des années une grande frustration : chaque année, de grandes études nationales sortent sur l’économie, le numérique, le climat, la santé, la consommation en France, mais les Outre-mer n’apparaissent tout simplement très peu ou pas du tout. Cette absence récurrente n’est pas anecdotique. Elle révèle un biais profond dans la production de données françaises et pose un vrai problème de représentation.
Des données difficiles à harmoniser
Les producteurs d’études aiment travailler sur des bases cohérentes, comparables, disponibles au même moment partout sur le territoire. Dans les Outre-mer, certaines données arrivent plus tard, sont plus compliquées à collecter ou reposent sur d’autres institutions (INSEE DOM, IEDOM, IEOM, DEAL, ARS, etc.).
Quand les chiffres ne sont pas parfaitement alignés avec ceux de l’Hexagone, beaucoup d’organismes préfèrent enlever les DOM-COM plutôt que de décaler la publication.
Un coût de collecte plus élevé
Les entreprises privées qui produisent des baromètres, des analyses sectorielles ou des sondages raisonnent en coûts. Envoyer des enquêteurs, constituer un échantillon représentatif ou organiser des focus groupes en Outre-mer coûte plus cher que sur le continent.
Dans un marché dominé par la logique économique, la tentation est grande de limiter l’étude aux zones les plus rentables et les plus accessibles.
Une vision encore trop centrée sur l’Hexagone
Beaucoup d’études sont pensées pour la France, mais cette France s’arrête souvent aux frontières continentales. Les commanditaires comme les cabinets d’études conçoivent encore trop souvent leurs enquêtes avec un cadre géographique implicite : Paris, les grandes métropoles, les régions du continent…
Cette vision réduit la diversité réelle du pays et donne une lecture très incomplète des grands enjeux nationaux.
Des marchés considérés comme trop petits
Dans les analyses économiques ou sectorielles, les statistiques ultramarines sont parfois jugées non significatives, parce que la population totale représente moins de 4 % de la population française.
Cette perception est trompeuse. Les outre-mer sont des territoires stratégiques, très différents les uns des autres, avec des tendances souvent plus rapides ou plus contrastées qu’en Hexagone : énergie, climat, tourisme, numérique, entrepreneuriat… Les exclure, c’est se priver d’un laboratoire à ciel ouvert.
Une faible circulation des données ultramarines
Le paradoxe est là : il existe nombre de données locales, produites par l’Insee, les IEDOM-IEOM, les DEAL, les ARS, les rectorats, les chambres consulaires, les observatoires territoriaux. Le problème vient de la diffusion. Ces données restent souvent dans des rapports régionaux, sans être reprises dans les grandes synthèses nationales. L’information existe, mais elle circule peu.
Un enjeu politique et symbolique majeur
L’absence des Outre-mer dans les études françaises n’est pas seulement un problème méthodologique. Elle affecte la visibilité des territoires, leur compréhension par le grand public, la qualité des décisions publiques, et même la représentation médiatique.
Quand les données manquent, les arbitrages nationaux se font sur une réalité tronquée.
Une évolution lente, mais réelle
Plusieurs signaux montrent que les choses bougent : intégration progressive de volets ultramarins dans certains rapports, montée en puissance des observatoires locaux, recours plus fréquent aux données locales dans les médias nationaux.
Cette évolution reste timide. Il est bien temps que les Outre-mer soient véritablement intégrés aux grandes études françaises.