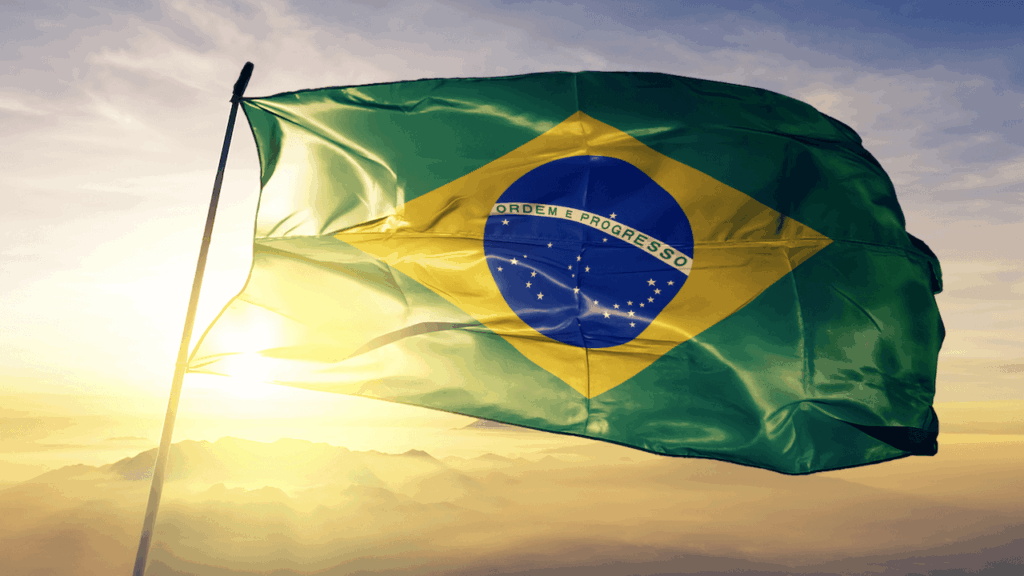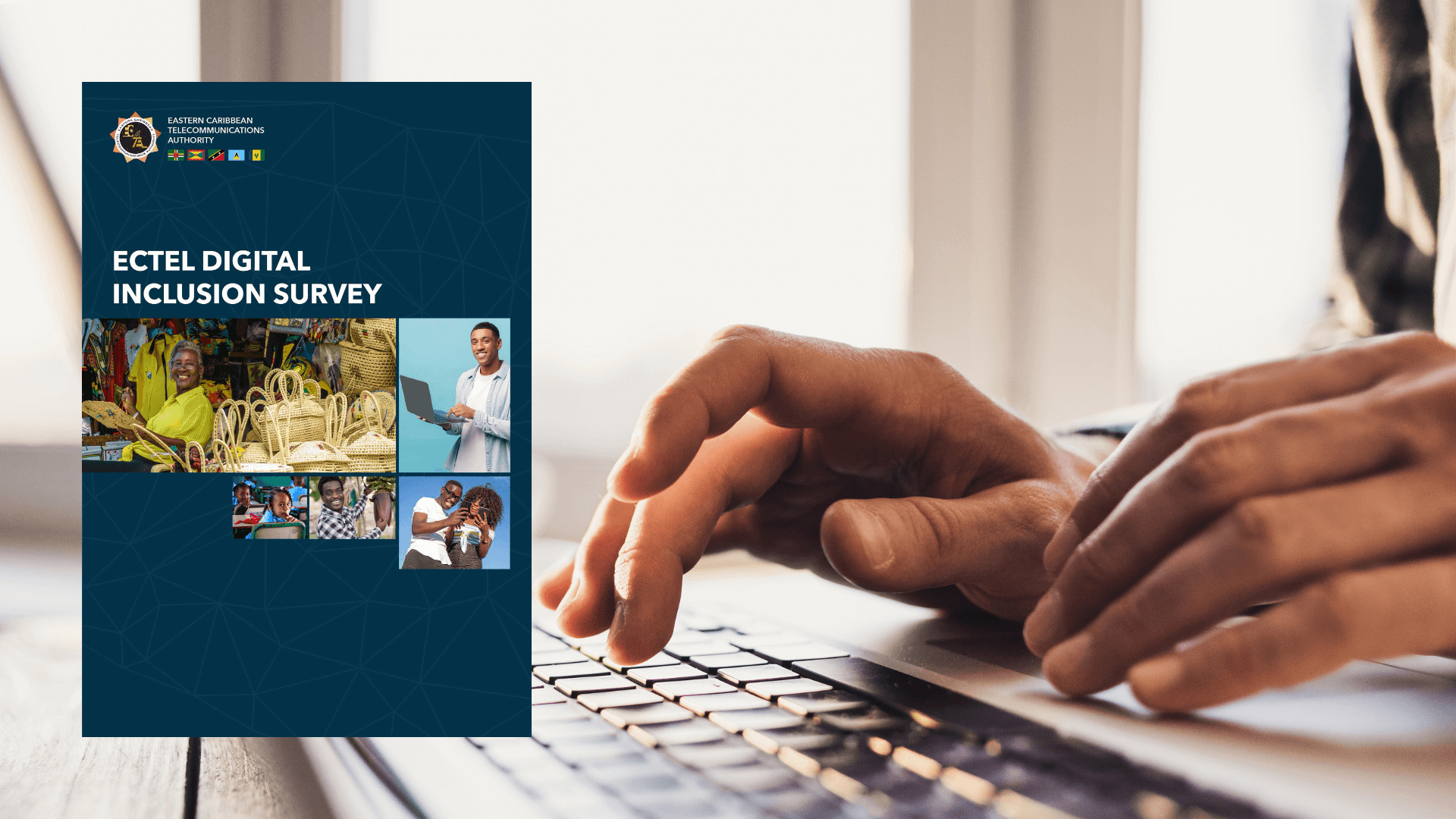Alors que le monde aura bientôt les yeux tournés vers Belém au Brésil, où se tiendra la COP30 sur le climat du 10 au 21 novembre, une évidence s’impose : le Brésil n’est pas seulement l’hôte du sommet, il en est aussi l’un des acteurs les plus scrutés.
Avec son PIB de près de 2 200 milliards d’euros, sa forêt amazonienne qui absorbe 5 % du CO₂ mondial, et sa position géopolitique clé dans l’Atlantique Sud, le pays pèse lourd.
Ses choix économiques et environnementaux ne s’arrêtent pas aux frontières de l’Amazonie : ils influencent directement les équilibres de la Grande Caraïbe, de la Guyane à la République dominicaine.
Économie : la puissance qui dicte les rythmes régionaux
Le Brésil, première économie d’Amérique latine, exporte chaque année pour environ 350 milliards d’euros. Ses produits – soja, sucre, volaille, éthanol – circulent dans les ports du bassin caribéen et concurrencent frontalement les petites filières locales.
À la Barbade ou à Sainte-Lucie, les producteurs de volaille peinent à rivaliser avec les 8 millions de tonnes exportées chaque année par le géant sud-américain.
Cette dynamique crée une dépendance économique insidieuse : fluctuations de prix, déséquilibres commerciaux et vulnérabilité des petites économies insulaires. À l’inverse, les importations brésiliennes soutiennent parfois l’activité des ports de Paramaribo ou de Georgetown. Le Brésil agit comme un métronome : quand il ralentit, la région tousse.
Sur le front énergétique, son avance est tout aussi déterminante. Le pays produit des milliards de litres d’éthanol par an. Cela pèse sur les stratégies énergétiques caribéennes, contraintes d’innover localement pour ne pas dépendre des fluctuations brésiliennes.
Politique et géopolitique : un centre de gravité diplomatique
Brasilia façonne le jeu régional à travers la CELAC, l’OEA et l’Association des États de la Caraïbe. Le pays multiplie les signaux d’ouverture : appui à une transition énergétique partagée, médiation dans la crise haïtienne, dialogue équilibré avec le Venezuela. Ces postures redéfinissent les alliances et reconfigurent les rapports entre les États caribéens.
Le Brésil investit aussi dans sa stature militaire : 20 milliards d’euros de budget annuel pour sa défense, dont une part croissante pour la surveillance maritime. Le message est clair : le pays veut sécuriser sa zone d’influence dans l’Atlantique Sud, et la Caraïbe en est un prolongement naturel.
Environnement : du poumon amazonien à la mer des Sargasses
Le sommet de Belém mettra sans nul doute en lumière une vérité dérangeante : les choix environnementaux du Brésil façonnent directement la santé écologique de la Grande Caraïbe.
- Déforestation amazonienne : malgré des progrès, 5 000 km² de forêts ont encore disparu en 2024, modifiant les cycles des pluies et les flux atmosphériques. Ces changements affectent les régimes climatiques des îles caribéennes, accentuant les sécheresses et la fréquence des ouragans.
- Sargasses : les chercheurs établissent désormais un lien entre la dégradation des sols amazoniens, les apports nutritifs des fleuves brésiliens et la prolifération des algues brunes. Ces masses flottantes, poussées par les courants atlantiques, asphyxient chaque année les littoraux guadeloupéens, martiniquais ou dominicains. Le coût global de la gestion des sargasses dépasse 120 millions d’euros par an pour la région, entre nettoyage, perte touristique et impacts sanitaires.
Le paradoxe est cruel : ce qui se joue en Amazonie finit par s’échouer sur les plages caribéennes.
Une influence diffuse mais décisive
Le Brésil ne se contente pas d’être un voisin : il est une force d’attraction. Ses décisions en matière de commerce, d’énergie, de climat ou de diplomatie modèlent le futur du bassin caribéen.
Pour la Grande Caraïbe, ignorer le Brésil revient à naviguer sans boussole. Le pays est un miroir des contradictions régionales : prospérité et inégalités, croissance et destruction, puissance et instabilité.
La COP30, en rassemblant à Belém les dirigeants du monde, devrait justement rappeler que le destin climatique et économique du continent américain – du Pará à Pointe-à-Pitre – est profondément interconnecté.