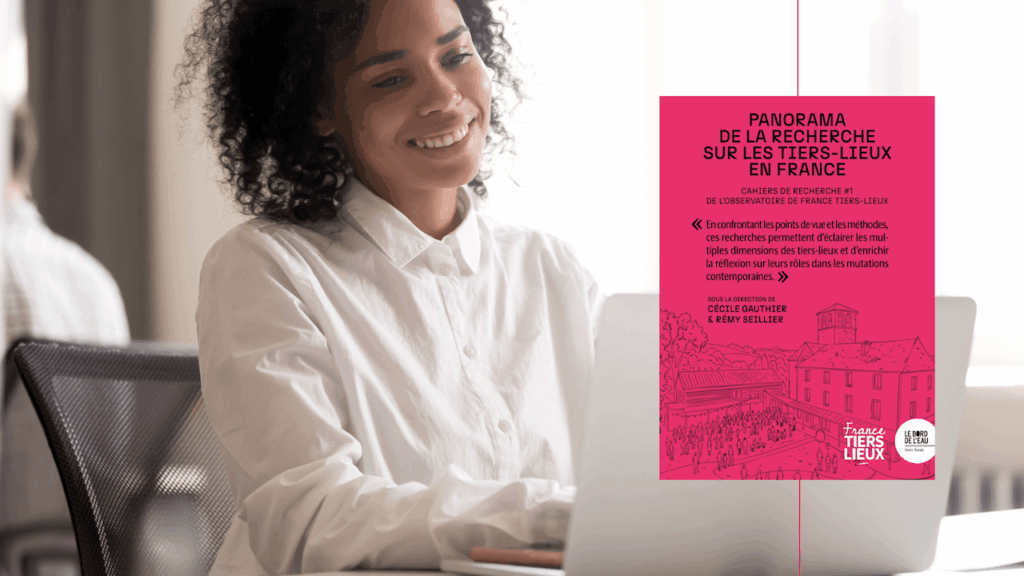Je découvre peu à peu le monde des tiers-lieu et je le trouve à la fois intéressant et difficile. J’ai d’ailleurs publier en février 2025 « Pourquoi il est difficile d’ouvrir et de pérenniser un tiers-lieu en Guadeloupe ».
Toujours en quête d’informations, je me suis intéressée au premier numéro des Cahiers de recherche de France Tiers-Lieux (2025). C’est un vaste panorama critique de ces espaces à la fois sociaux, économiques, culturels et politiques.
Voici 10 enseignements majeurs tirés de cette publication.
Un concept aux définitions multiples
Les tiers-lieux ne se résument pas à une seule réalité. Ils oscillent entre espaces de convivialité, lieux de production collaborative, incubateurs d’innovation sociale ou dispositifs d’action publique. Ce flou conceptuel, bien que stimulant, appelle à des clarifications.
Un objet de recherche interdisciplinaire
Sociologie, urbanisme, science politique, géographie, gestion… De nombreuses disciplines s’emparent du sujet, rendant nécessaire une approche décloisonnée pour comprendre leurs dimensions multiples.
Une hybridation entre initiatives citoyennes et politiques publiques
Les tiers-lieux peuvent être des outils d’empowerment collectif, tout en étant intégrés à des dispositifs institutionnels. Loin de l’opposition entre autonomie et récupération, c’est la logique d’« imbriquation » qui prédomine.
Des laboratoires de transitions territoriales
Ces espaces sont souvent des terrains d’expérimentation pour des transitions écologique, économique ou sociale. Leur capacité à générer du changement local repose sur l’engagement des usagers et la souplesse de leur gouvernance.
Un soutien public massif mais questionné
L’État français a investi près de 300 millions d’euros en cinq ans pour développer les tiers-lieux. Cette implication nécessite aujourd’hui des évaluations rigoureuses de leurs effets réels sur les territoires.
Des formes innovantes d’action sociale et de santé
Les « tiers-lieux de santé » renouvellent les relations entre soignants, patients et citoyens dans une logique de démocratie sanitaire, tandis que d’autres investissent le champ du médico-social ou du travail social.
Des enjeux de gouvernance et de reconnaissance
Les tiers-lieux aspirent à l’autonomie mais doivent composer avec des modèles économiques fragiles, des injonctions à l’innovation et une reconnaissance encore inégale selon les secteurs.
Un ancrage territorial ambivalent
Si les tiers-lieux participent à la fabrique urbaine et à la revitalisation de certains territoires, leur impact reste difficile à mesurer. Leur mise en réseau avec les acteurs de l’ESS est identifiée comme un levier clé de leur efficacité.
Une porosité entre recherche et action
La recherche sur les tiers-lieux s’inscrit souvent dans une logique de recherche-action. Les dispositifs comme les CIFRE, ou les études participatives sur les tiers-lieux nourriciers, illustrent cette hybridation.
Un enjeu démocratique majeur
À l’instar des third places définis par Ray Oldenburg, les tiers-lieux sont perçus comme des espaces de dialogue et de désaccord productif, essentiels pour revitaliser la démocratie locale et la cohésion sociale.