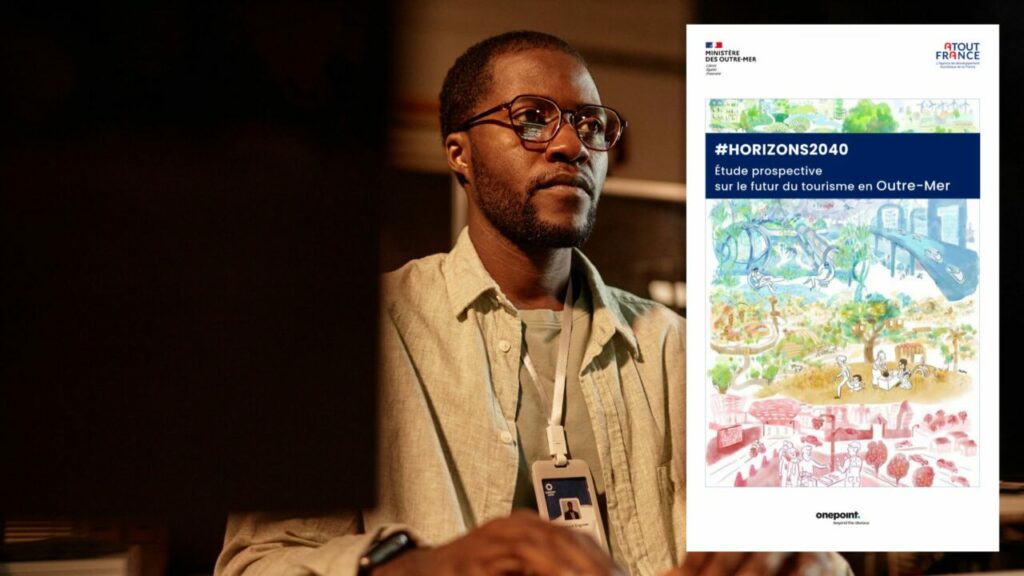Alors que les territoires ultramarins affrontent déjà les conséquences du changement climatique, de la dépendance économique et des tensions sociales, Atout France et la Direction générale des Outre-mer (DGOM) ont lancé une démarche prospective ambitieuse : Horizons 2040 Outre-mer. Publiée en octobre 2025, cette étude vise à anticiper les mutations qui transformeront le tourisme dans ces régions d’ici 15 ans.
L’objectif est clair : mieux comprendre pour mieux agir, en aidant les acteurs locaux à bâtir une stratégie touristique résiliente, adaptée à leurs réalités insulaires et à leurs vulnérabilités structurelles.
Une méthode rigoureuse et participative
Cette déclinaison ultramarine de l’étude nationale Horizons 2040 s’appuie sur une méthodologie solide : veille scientifique et institutionnelle, entretiens approfondis avec des acteurs du tourisme (comités touristiques, chercheurs, compagnies aériennes, experts du GIEC, etc.), et ateliers de projection dans les 3 grands bassins : Caraïbes, Océan Indien et Pacifique.
L’idée n’est pas de prédire l’avenir, mais de cartographier les tendances lourdes et signaux faibles qui pèseront sur l’évolution du tourisme d’ici 2040.
Les analyses s’articulent autour de 5 systèmes de changement interdépendants :
- Environnement et rapport au vivant : changement climatique, tensions sur les ressources, biodiversité menacée.
- Économique et social : dépendance à la métropole, fragilité des infrastructures, inégalités sociales.
- Humain : attentes des nouvelles générations, montée du slow tourisme et des valeurs éthiques.
- Politique : instabilité institutionnelle, recomposition des relations régionales et européennes.
- Technologie : innovations, décarbonation, numérisation et nouveaux modes de mobilité.
Les Outre-mer, laboratoires du changement mondial
Le rapport souligne que les Outre-mer français sont des éclaireurs des crises et transitions planétaires. Les territoires insulaires, par leur géographie et leur dépendance à l’extérieur, expérimentent déjà les bouleversements qui s’étendront ailleurs :
- Ressources sous tension : l’eau potable se raréfie (jusqu’à un quart de la population sans accès quotidien en Guadeloupe ou Guyane), les coûts de l’énergie et des matériaux explosent, la dépendance alimentaire s’aggrave (+22 % en dix ans).
- Changement climatique accéléré : érosion côtière, montée des eaux (+0,3 m attendus d’ici 2040), cyclones plus intenses, disparition des récifs coralliens (jusqu’à 99 % à +1,6°C selon le GIEC).
- Risques sociaux et économiques : crises identitaires, tensions intergénérationnelles, difficultés d’accès au foncier, effondrement de certaines filières touristiques traditionnelles.
À travers ces constats, Atout France plaide pour une transition profonde du modèle touristique : diversification des clientèles, ancrage local, tourisme plus sobre et inclusif.
3 paradoxes à résoudre
Les auteurs identifient 3 paradoxes structurants :
- Le paradoxe de l’image : le tourisme ultramarin repose encore largement sur le mythe de la plage paradisiaque, alors que la richesse culturelle, artisanale et patrimoniale reste sous-exploitée.
- Le paradoxe géographique : la fragmentation des territoires entre trois océans empêche une vision unifiée et renforce les écarts de développement et d’attractivité.
- Le paradoxe environnemental : les Outre-mer abritent 80 % de la biodiversité française, mais concentrent aussi les infrastructures les plus exposées aux aléas naturels.
Des initiatives locales inspirantes
Le rapport met en avant des exemples concrets de transition :
- Le projet hôtelier BAM en Martinique, conçu selon des principes d’architecture bioclimatique et d’autonomie énergétique.
- La compagnie Corsair, qui expérimente le tri et le recyclage des déchets à bord sur ses liaisons vers la Caraïbe.
- Le Smart Cable Nouvelle-Calédonie–Vanuatu, premier câble sous-marin au monde intégrant des capteurs environnementaux pour surveiller le climat et la sismicité.
Ces initiatives démontrent la capacité d’innovation des territoires ultramarins, souvent pionniers malgré leurs contraintes logistiques et économiques.
Vers un tourisme plus sobre et résilient
L’étude insiste sur l’urgence de repenser la dépendance à l’aérien, alors que 80 % des touristes accèdent aux territoires par avion. Le prix des billets a déjà augmenté de 25 % en 5 ans.
La transition vers un tourisme bas carbone impose donc de nouvelles stratégies :
- développer les énergies renouvelables locales ;
- encourager les séjours plus longs et moins fréquents ;
- investir dans la rénovation écoénergétique des hébergements ;
- promouvoir les mobilités douces et maritimes inter-îles.
L’idée n’est pas de fermer les territoires, mais de rendre chaque voyage plus conscient, plus utile et plus respectueux du vivant.
4 scénarios pour 2040
Le travail prospectif propose quatre scénarios contrastés qui dessinent autant de futurs possibles :
- Le village mondialisé, où la technologie et la coopération internationale permettent un tourisme durable et connecté.
- Les élites globalisées, un monde inégalitaire où seuls les plus riches voyagent encore loin.
- Les territoires communautaires, misant sur la proximité, l’autonomie et les circuits courts.
- L’archipélisation du monde, dans lequel les destinations ultramarines tirent parti de leur singularité culturelle et de leur ancrage régional.
Ces scénarios ne sont pas des prédictions mais des outils d’aide à la décision. Ils invitent les acteurs publics et privés à choisir collectivement la voie à emprunter.
Un message clair : anticiper pour agir
« L’anticipation n’est pas un luxe : c’est un impératif stratégique », rappellent les signataires du rapport, parmi lesquels Christian Mantei (président d’Atout France) et Olivier Jacob (directeur général des Outre-mer).
Leur message est limpide : face à la montée des risques climatiques et sociaux, agir maintenant coûte moins cher que réparer plus tard.
Pour que le tourisme ultramarin reste un moteur économique et social, il doit devenir un levier de transition, un outil de cohésion et un laboratoire d’innovation territoriale. Les Outre-mer, plus que tout autre espace français, ont la capacité d’incarner ce tourisme du futur : durable, résilient, choisi.