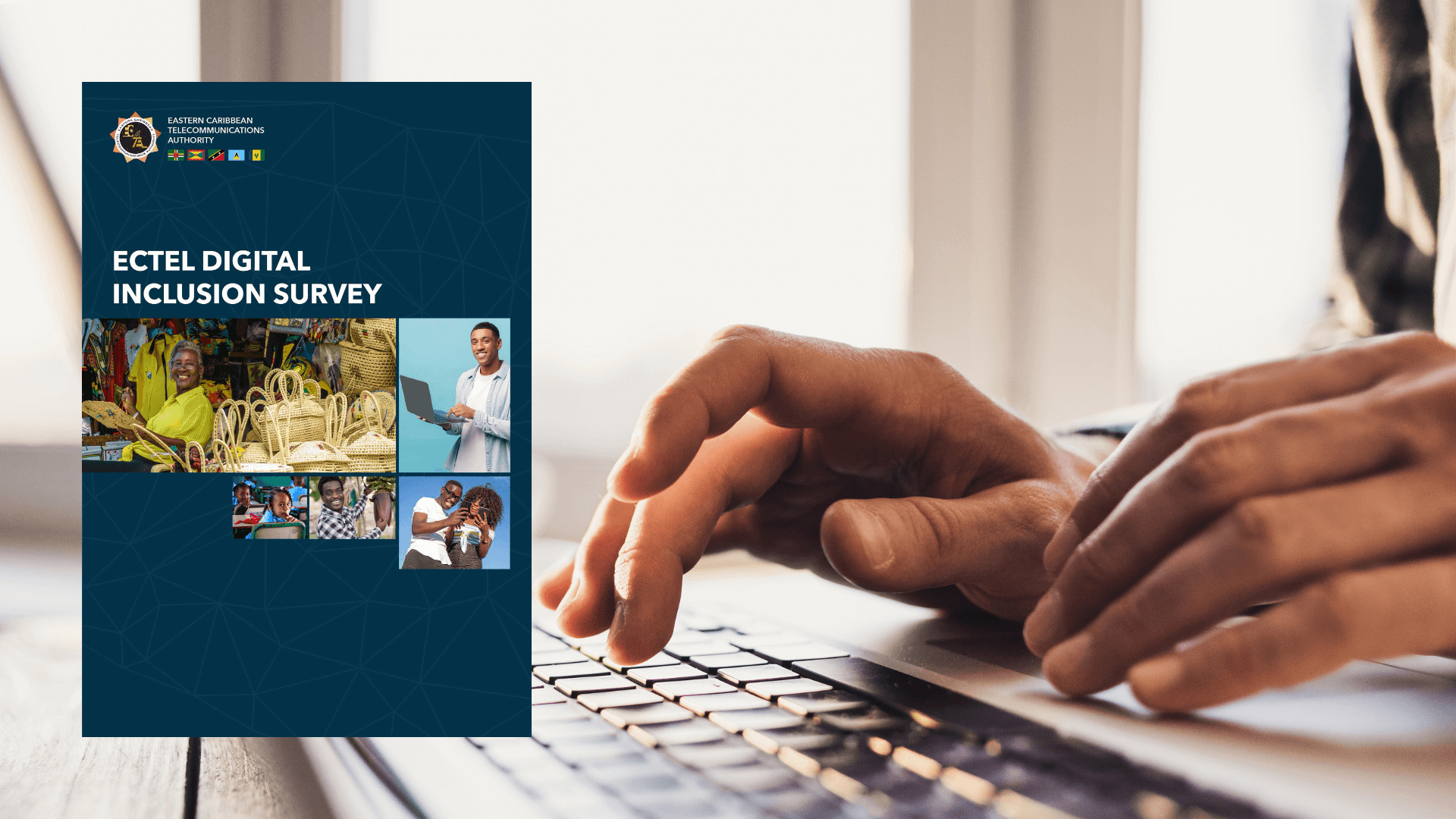Depuis toujours, des centaines de milliers d’habitants de la Grande Caraïbe vivent face à la mer. Sur le littoral, se trouvent les plus grandes villes, les ports, les zones touristiques, les plages les plus fréquentées. Le littoral est à la fois le moteur économique et la vitrine des territoires. Pourtant, cette proximité tant recherchée avec la mer devient de plus en plus risquée.
Une histoire qui commence sur le rivage
Tout a commencé avec la colonisation. Les Européens ont bâti les premières villes sur les côtes, pour le commerce et le contrôle maritime. De La Havane à Fort-de-France, de Bridgetown à Pointe-à-Pitre, la mer était la porte d’entrée du monde.
Aujourd’hui encore, les littoraux concentrent les ports, les zones industrielles, les infrastructures touristiques et les emplois. Dans des îles souvent montagneuses, les plaines côtières sont les rares espaces faciles à aménager. Pas étonnant que plus de 70 % des habitants vivent à moins de 5 km de la mer en Guadeloupe.
Une beauté sous menace
Vivre près de la mer, c’est un rêve caribéen : la plage à portée de main, les couchers de soleil, le sentiment de liberté. Ces zones attirent les investisseurs, les retraités, les travailleurs du tourisme, les commerçants. Les activités économiques s’y concentrent, les infrastructures s’y développent, et la population continue d’y affluer malgré les alertes.
Ce cadre idyllique cache une réalité bien plus inquiétante. Le littoral est aujourd’hui l’un des espaces les plus menacés de la planète.
- Montée du niveau de la mer : les projections annoncent entre 30 et 80 cm d’ici 2100. Une perspective dramatique pour les zones basses du Belize, de la Dominique ou des Bahamas, où des quartiers entiers risquent d’être submergés.
- Cyclones et tempêtes tropicales : chaque saison rappelle la vulnérabilité de ces territoires. Les ouragans détruisent habitations et routes, comme à Saint-Martin en 2017, comme en Jamaïque, en Haîti et à Cuba en 2025.
- Érosion côtière : la mer grignote les plages, accentuée par la destruction des mangroves, les constructions anarchiques et l’extraction de sable.
- Pollution et dégradation des écosystèmes : mangroves et récifs coralliens disparaissent, affaiblissant encore la protection naturelle contre les tempêtes.
Et puis, il y a les sargasses. Ces algues brunes, poussées par les courants et la chaleur, s’échouent depuis plus de dix ans sur les côtes caribéennes. Leur décomposition dégage des gaz toxiques, rendant la vie littorale invivable pendant des semaines : odeurs, corrosion des équipements, chute du tourisme, fermetures de commerces. Elles symbolisent à elles seules le déséquilibre environnemental qui menace la région.
Des enjeux cruciaux pour l’avenir
Les gouvernements, les urbanistes et les citoyens sont désormais face à un choix : continuer à densifier le littoral, ou repenser en profondeur la manière d’habiter la Caraïbe.
Trois priorités s’imposent :
- Réorganiser l’aménagement du territoire pour limiter la construction en zones à risques et réhabiliter les écosystèmes protecteurs.
- Renforcer la résilience : adapter les bâtiments, préparer les populations, anticiper les crises.
- Réconcilier économie et environnement, en développant une véritable économie bleue durable : pêche responsable, tourisme raisonné, énergies marines propres.
Le littoral caribéen restera un lieu de vie, d’échanges et de beauté. Cependant, il doit devenir un espace protégé et respecté, pas sacrifié au profit de la rentabilité immédiate. Apprendre à vivre avec la mer, et non contre elle, c’est le défi des prochaines décennies pour tous les territoires de la Grande Caraïbe.