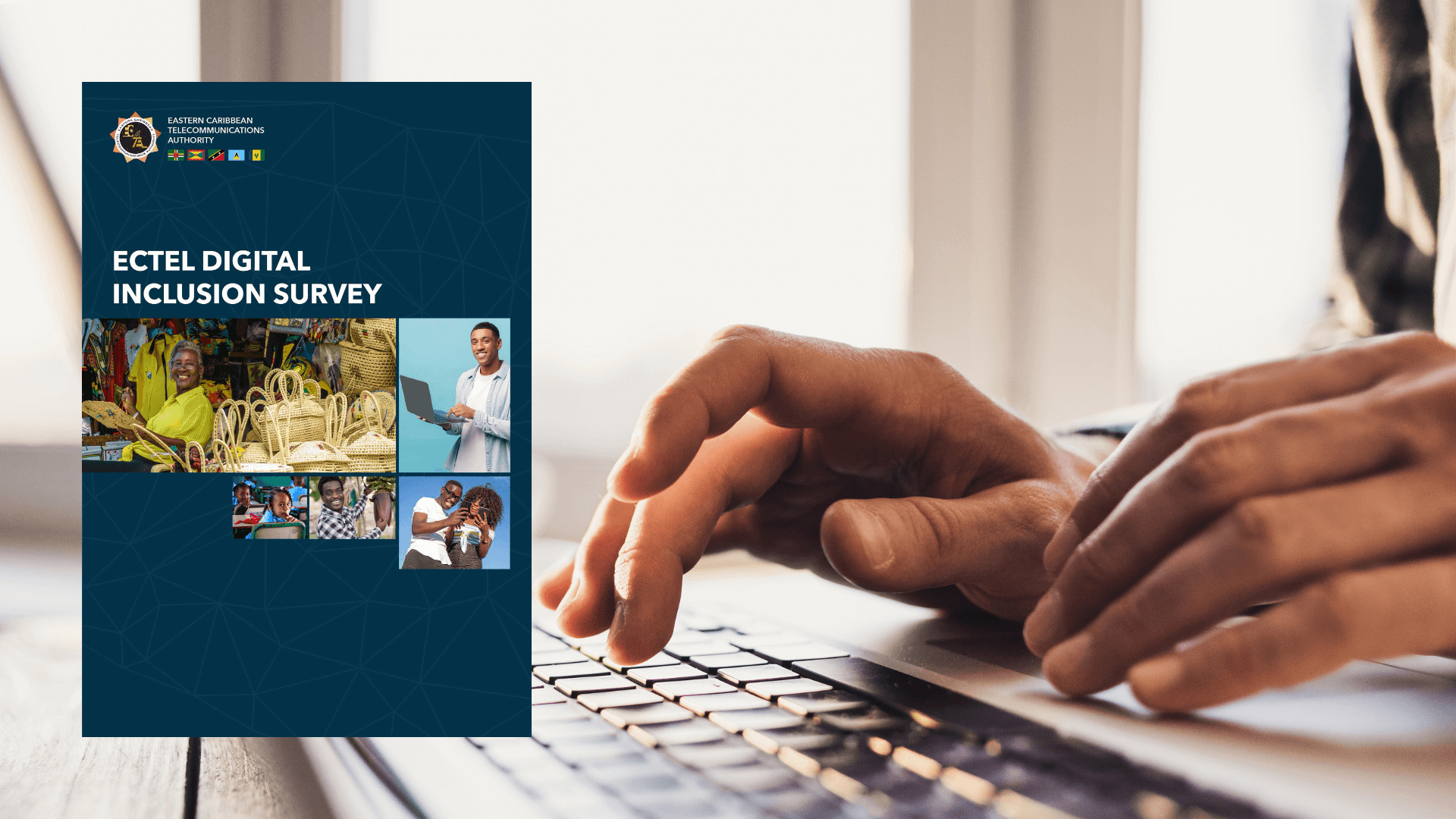La plupart des États caribéens sont d’immenses puissances maritimes. Leur territoire sous-marin dépasse de très loin leurs frontières terrestres. Dans une période où la valeur se déplace vers l’immatériel, la donnée, la biodiversité et l’innovation climatique, cette richesse océanique change tout.
Des territoires minuscules, des océans gigantesques
Les zones économiques exclusives (ZEE) accordent jusqu’à 200 milles nautiques de souveraineté sur les ressources marines. Ce cadre juridique transforme des pays de quelques centaines de kilomètres carrés en acteurs majeurs dans les eaux régionales.
Quelques ordres de grandeur suffisent pour comprendre :
- Bahamas : environ 630 000 km² de ZEE, plus que la superficie de la France hexagonale.
- Barbade : près de 185 000 km², pour un territoire terrestre de 430 km².
- Jamaïque : autour de 270 000 km², alors que l’île ne fait que 11 000 km².
- Trinité-et-Tobago : environ 75 000 km², soit quinze fois sa surface terrestre.
- Guadeloupe et Martinique (France) : près de 140 000 km² de ZEE cumulée, un élément stratégique pour l’Union européenne dans la Caraïbe.
La Grande Caraïbe n’est donc pas un archipel de petites terres isolées. C’est une constellation d’États océaniques, détenteurs d’un espace marin qui structure leur avenir.
Un capital immatériel encore sous-exploité
L’intérêt ne repose pas uniquement sur l’extraction de ressources. La prochaine décennie sera marquée par la montée en puissance d’activités fondées sur la connaissance, la science, la data et les partenariats internationaux. Les ZEE deviennent alors des leviers économiques discrets mais puissants.
Licences de recherche scientifique
Les eaux caribéennes attirent des universités, instituts océanographiques, centres climat et entreprises spécialisées. Les territoires peuvent délivrer des autorisations pour :
- la cartographie des fonds marins,
- l’étude des écosystèmes,
- l’observation du climat,
- la recherche en géodynamique.
La valeur est double : revenus directs et insertion dans les grands réseaux scientifiques mondiaux.
Exploration énergétique et innovations marines
La région se tourne vers de nouvelles technologies marines :
- énergie thermique des mers (ETM),
- courants marins,
- éolien offshore,
- matériaux critiques des grands fonds.
Des pays comme Trinidad-and-Tobago, Barbade ou Guyane explorent déjà ces voies. La Caraïbe peut devenir un laboratoire énergétique adapté à un monde post-pétrole.
Conservation financée : l’ère des « blue bonds »
Ce mécanisme est simple : réduire la dette en échange de la protection de zones marines.
La région a déjà ouvert la voie.
- Belize a restructuré 553 millions de dollars de dette en s’engageant sur la conservation de son espace marin.
- Barbade a réalisé en 2022 une opération de 150 millions de dollars liée à la préservation de ses eaux.
Les ZEE deviennent un actif environnemental monétisable. Une nouvelle manière d’associer finances publiques, développement durable et souveraineté.
L’océan, un espace politique et économique
Les ZEE renforcent la position des États caribéens dans plusieurs domaines :
- négociations climatiques internationales,
- sécurité alimentaire avec les politiques de pêche durable,
- contrôle des routes maritimes,
- protection de la biodiversité,
- attractivité pour les entreprises de data climatique.
L’océan est aussi un espace de récit territorial. Il permet aux États d’exister autrement, d’affirmer leur identité, et de se projeter dans une économie où la valeur n’est plus uniquement matérielle.
Ce que cela change pour la Grande Caraïbe
La région n’est pas condamnée à reproduire des modèles de croissance fragiles. Elle possède un atout stratégique qui ne nécessite pas de bétonnage ni de dépendance massive aux importations. L’avenir peut se construire autour d’une vision océanique ambitieuse, qui combine :
- savoir-faire technologique,
- coopération régionale,
- gestion durable,
- innovation scientifique,
- nouvelles formes de financement.
Les ZEE sont un levier puissant pour réinventer le développement caribéen. Un trésor invisible, à peine exploré, qui mérite enfin d’être mis au cœur des stratégies régionales.