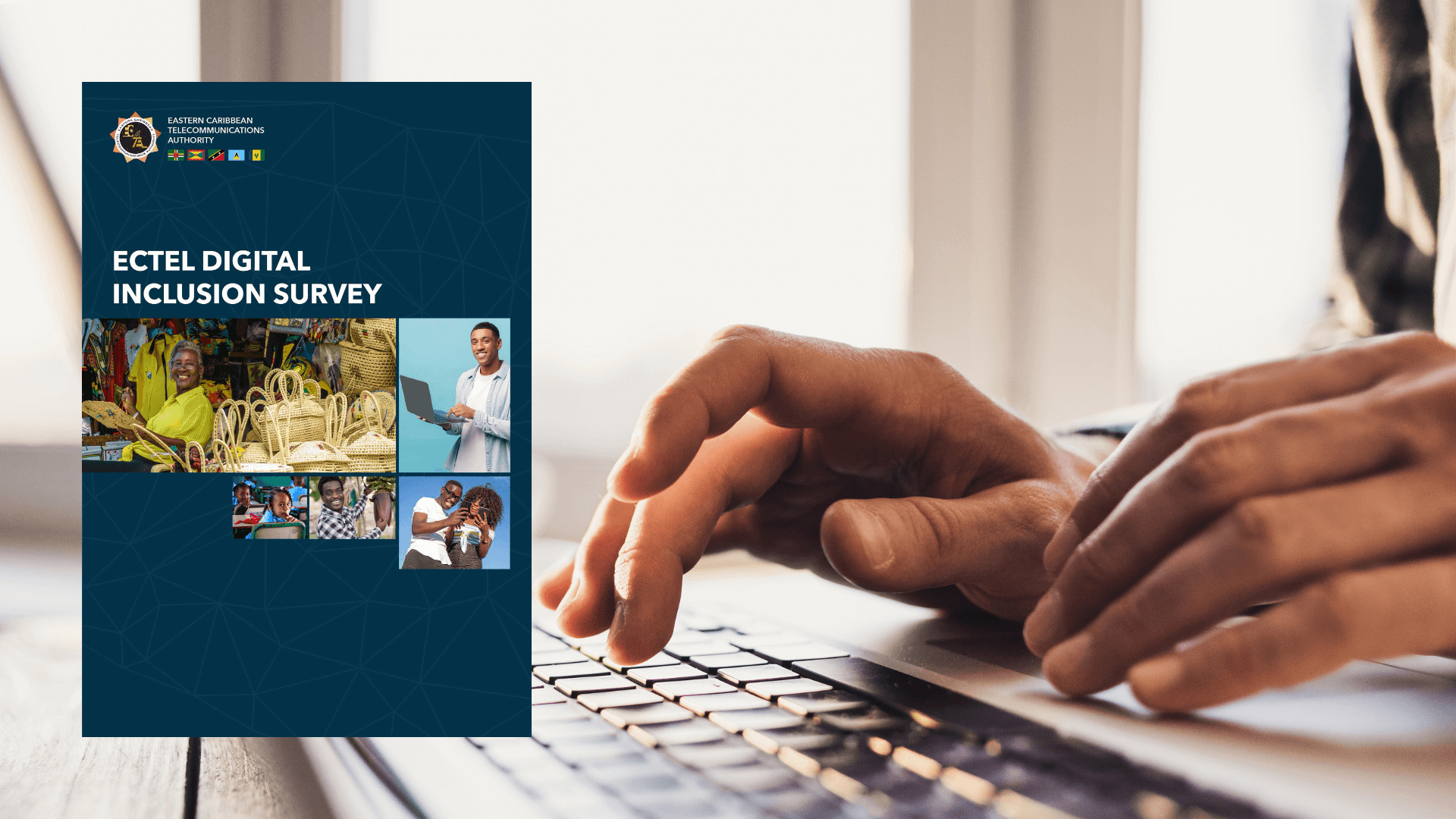Depuis plus d’un demi-siècle, Cuba fait de sa médecine un instrument de puissance douce. L’île a bâti une réputation internationale sur la qualité de la formation de ses médecins et sur leur disponibilité lors de crises humanitaires majeures. Pourtant, derrière cette image de solidarité internationale, la politique d’envoi de brigades médicales à l’étranger revêt une dimension économique essentielle à la survie du régime cubain, fragilisé par l’embargo américain et par une économie en crise chronique.
Une vitrine humanitaire aux ressorts économiques puissants
La « diplomatie médicale » cubaine débute dans les années 1960, au lendemain de la révolution. Fidel Castro envoie des médecins en Algérie, puis dans d’autres pays du Sud, pour soutenir les luttes anticoloniales et renforcer les alliances politiques. Ce dispositif s’est institutionnalisé : en 2025, plus de 22 000 professionnels de santé cubains sont déployés dans plus de 50 pays, d’Amérique latine à l’Afrique, en passant par les Caraïbes.
Au-delà de la portée symbolique, c’est un pilier économique majeur.
En 2018, les « exportations de services médicaux » ont rapporté environ 7,7 milliards de dollars, soit la première source de devises du pays, loin devant le tourisme ou le nickel. Aujourd’hui encore, cette manne représente entre 6 et 8 milliards de dollars par an, selon les estimations de chercheurs indépendants. Ces revenus permettent à l’État de financer une partie de son système de santé et de son budget social, mais aussi de compenser les pertes dues au blocus américain et à la baisse des investissements étrangers.
Des accords stratégiques avec les pays partenaires
Pour les pays bénéficiaires, ces missions sont souvent essentielles. Au Venezuela, des milliers de médecins cubains ont été déployés en échange de livraisons de pétrole à prix préférentiel, dans le cadre du programme « Pétrole contre médecins ». Au Brésil, le programme Mais Médicos lancé en 2013 a permis d’envoyer plus de 8 000 praticiens dans les zones rurales. Pendant la pandémie de Covid-19, Cuba a également dépêché des brigades en Italie, en Andorre et dans plusieurs pays caribéens, consolidant son image d’acteur global de la santé.
Derrière les discours de coopération, ces accords sont souvent déséquilibrés : les États partenaires versent les salaires directement au gouvernement cubain, qui en reverse seulement 5 % à 25 % aux médecins sur le terrain. Le reste est capté par l’État, selon des rapports d’ONG et du Département d’État américain. Ces pratiques sont dénoncées par certaines organisations internationales comme une forme d’« exploitation économique » ou de « travail forcé ».
Entre prestige et contrôle
Pour le régime cubain, ces missions remplissent une triple fonction : financière, diplomatique et politique. Elles permettent d’alimenter les caisses de l’État, d’entretenir un réseau d’alliances dans le monde et de renforcer la légitimité d’un système autoritaire en crise.
La figure du médecin cubain, dévoué et compétent, continue d’incarner un idéal révolutionnaire de solidarité et d’excellence. Cependant, elle sert aussi à masquer la réalité d’un pays où les pénuries, les coupures d’électricité et l’exode des professionnels s’aggravent.
Dans les faits, de nombreux médecins voient dans ces missions une opportunité : leurs revenus, même amputés, restent supérieurs à ceux qu’ils toucheraient à Cuba, où le salaire moyen d’un praticien oscille autour de 60 dollars par mois. Cependant, les conditions d’exercice à l’étranger sont strictement encadrées : limitation des déplacements, surveillance constante, confiscation des passeports. Quitter la mission sans autorisation expose à de lourdes sanctions et à plusieurs années d’interdiction de retour sur l’île.
Un modèle sous pression
Ce modèle, longtemps présenté comme une réussite, montre aujourd’hui ses fragilités. En 2018, le Brésil a mis fin au programme Mais Médicos après des tensions sur les conditions imposées aux praticiens cubains. D’autres pays, notamment en Amérique latine, réclament davantage de transparence sur la gestion des contrats. Parallèlement, la crise économique interne et les vagues de départs de médecins vers d’autres pays affaiblissent la capacité de Cuba à maintenir la qualité de ses services de santé sur son propre territoire.
Les défis s’accumulent : chute du tourisme, baisse des revenus pétroliers vénézuéliens, sanctions renforcées, inflation galopante. Dans ce contexte, les « exportations » de services médicaux restent l’un des rares leviers de survie financière du régime. Un équilibre fragile, entre pragmatisme économique et maintien du récit révolutionnaire.
Une diplomatie entre idéal et nécessité
La diplomatie médicale cubaine illustre à la fois la résilience et les contradictions d’un système. Symbole de solidarité pour certains, instrument de contrôle et de rente pour d’autres, elle cristallise les tensions d’un pays contraint de monétiser son capital humain pour survivre.
Dans une économie sous perfusion, la santé publique est devenue un produit d’exportation stratégique. Et c’est là toute l’ambiguïté du modèle cubain : sauver des vies à l’étranger, tout en cherchant à sauver la sienne.