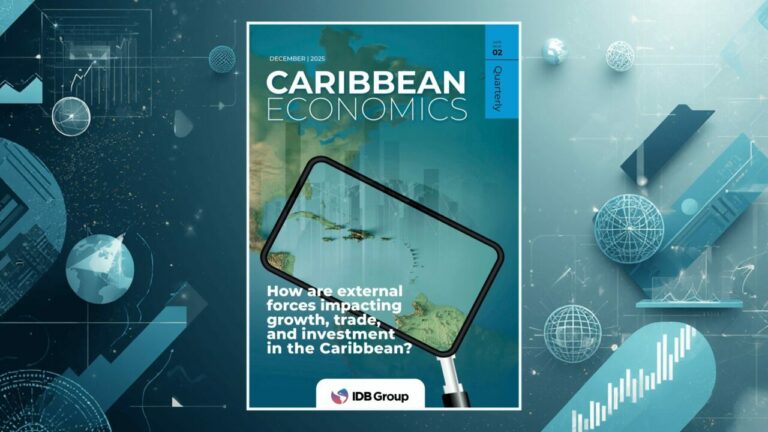La Caraïbe est devenue, au fil des siècles, un carrefour incontournable de l’évasion et de l’optimisation fiscales. Une architecture financière sophistiquée attire multinationales, fortunes privées et investisseurs internationaux.
Une histoire coloniale qui a tracé la voie
Dès le XVIIᵉ siècle, les puissances coloniales utilisaient les îles caribéennes comme zones franches commerciales. Le sucre, le rhum et le commerce triangulaire ont fait de la région un espace où circulaient marchandises et capitaux, souvent à l’écart des contrôles métropolitains. Après les indépendances des années 1960-1980, de nombreux petits États insulaires ont vu dans la fiscalité légère une arme économique pour attirer devises et entreprises.
Fiscalité zéro et secret bien gardé
Les îles Caïmans incarnent ce modèle : pas d’impôt sur le revenu, pas d’impôt sur les sociétés, et une réglementation qui attire banques et hedge funds. Avec 70 000 sociétés enregistrées pour 70 000 habitants, le territoire illustre le poids de cette industrie.
Aux Bahamas, la fiscalité avantageuse et la confidentialité bancaire – longtemps sacralisée – ont bâti une réputation mondiale. Les Bermudes, de leur côté, sont devenues un haut lieu de l’assurance et de la réassurance internationale.
Un positionnement stratégique
Située aux portes des États-Unis, la région bénéficie d’une localisation idéale. Les flux financiers circulent rapidement vers Miami, New York ou Londres. Cette proximité géographique, combinée à un cadre juridique souple, a consolidé le rôle de la Caraïbe comme carrefour de l’offshore.
Une économie dépendante de l’offshore
Privés de ressources naturelles pour beaucoup, les États caribéens ont misé sur les services financiers pour compenser leur vulnérabilité. Dans certains territoires, la finance offshore représente une part significative du PIB, offrant emplois qualifiés et recettes publiques, mais créant aussi une dépendance économique difficile à réformer.
Pression internationale, adaptation locale
Face aux critiques, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Groupe d’action financière (GAFI) et l’Union européenne publient régulièrement des listes noires ou grises, dénonçant les pratiques de la Barbade, de Trinidad-and-Tobago ou des îles Vierges britanniques. Cependant, la réalité est plus nuancée : les législations locales évoluent pour rester attractives tout en répondant aux standards internationaux. Résultat : la Caraïbe conserve son image de refuge fiscal, tout en affirmant jouer un rôle légal d’optimisation et de gestion de capitaux.
Entre opportunité et soupçons permanents
La Caraïbe incarne une contradiction : ce sont des territoires fragiles, dépendants de l’extérieur, qui se sont bâtis une survie économique grâce à l’évasion et l’optimisation fiscales. Toutefois, ce choix les expose à une réputation sulfureuse et à une pression constante des grandes puissances. Un équilibre instable, qui place la région au cœur des débats mondiaux sur la justice fiscale.