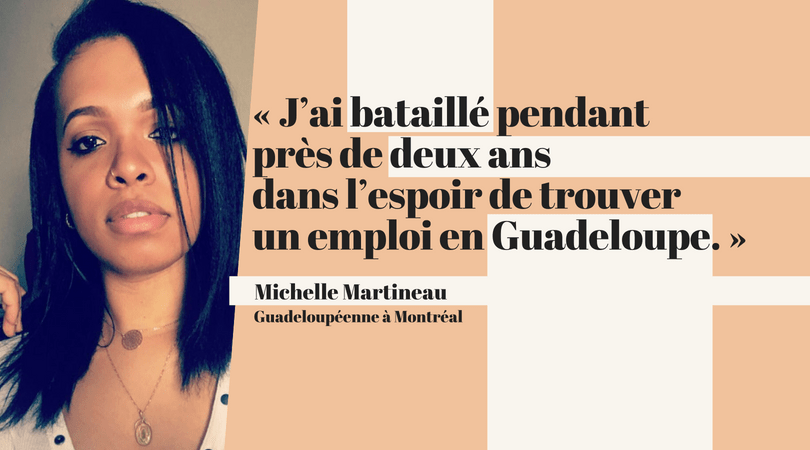J’ai lancé cette rubrique Spécial invité, afin que d’autres voix que la mienne puissent s’exprimer, parce que je crois en la pluralité des points de vue comme source riche de réflexion. Il y a quelques semaines, j’ai publié un texte de Michelle Martineau, qui a suscité un bel intérêt. Elle m’en a envoyé un autre, sur un sujet différent, mais également intéressant. Je ne pouvais que le publier. Le voici donc.
Guadeloupe ou Karukera, îles aux belles eaux, ma maison, mes racines. Maison que j’ai dû quitter en 2015 pour poursuivre mes études à l’étranger, au Canada. Bien sûr, une nouvelle aventure commence, mais j’ai laissé derrière moi ma famille, mes amis, mes racines.
Karukera. J’ai dû la quitter parce que mes projets professionnels n’étaient plus adaptés au « pays ». Comme je détenais une maitrise en droit à l’époque, il m’a été affirmé que je possédais trop de diplômes pour pouvoir rester en Guadeloupe : la surqualification. J’ai bataillé pendant près de deux ans dans l’espoir de trouver un emploi afin d’apporter ma pierre à l’édifice dans le paysage économique et social de ma chère Guadeloupe. Les désillusions ne se sont pas faites attendre.
Rendez-vous sur rendez-vous à Pôle emploi. Une conseillère de cette institution m’a soutenu que mon projet de partir faire des études au Canada relevait de l’utopie. Quelques mois plus tard, à ma plus grande joie, j’ai été acceptée et j’ai décidé de partir. Aller simple vers Montréal.

Ce récit n’est pas un cas unique. De nombreux Guadeloupéens et Martiniquais, le font chaque année : c’est la fuite des cerveaux. Dès l’obtention du Bac ou après une licence, partir vers d’autres horizons constitue certes un choix, mais de plus en plus une nécessité. Je fais partie de cette jeunesse qui a eu la possibilité de partir loin et de réaliser ses rêves, mais qu’en est-il de la jeunesse restée à bord ?
Dans une société antillaise où le taux de chômage est supérieur à celui de l’Hexagone, un jeune antillais diplômé se voit presque dans l’obligation de partir, parce qu’il n’y a rien au « pays », parce que le « pays » n’a plus rien à offrir.
Peut-on alors parler de génocide par substitution 2.0 ? Les différentes politiques adoptées durant le cours de ces dernières décennies ne semblent pas avoir réglé le problème. Au contraire, la jeunesse antillaise est de plus en plus tentée de s’expatrier, de quitter sa chère terre natale.
En écrivant ce billet, je ne tiens absolument pas à adopter un discours pessimiste. Mais il s’agit d’établir une pensée constructiviste, car, dans toute difficulté, l’espoir n’est jamais très loin. Il convient toutefois de tendre le miroir aux politiques publiques pour prendre conscience de la réalité du terrain. Les Antilles se vident de ses têtes pensantes pour différentes raisons qui ne sont de ma portée, seuls les hommes politiques détiennent les réponses.
Toutefois, avec ce miroir et cette prise de conscience, un véritable travail de reconstruction en faveur de la jeunesse antillaise est possible. Ce retour au pays natal que souhaitent certains jeunes peut se concrétiser. Il faut juste entendre une bonne fois pour toutes les désidératas de cette jeunesse qui ne cherche qu’à porter son « pays » au sommet. On dit souvent que l’herbe y est plus verte ailleurs, mais il suffirait de retirer les mauvaises herbes qui se sont accumulées dans notre jardin créole ; car en dessous, se cache un potentiel que nul ne peut ignorer. La jeunesse antillaise est porteuse d’espoir et de plus-value tant sur le plan politique, économique que culturel.
Bien entendu, établir des réformes sur une longue durée serait plus que bénéfique pour cette jeunesse qui souhaite rentrer au pays natal, mais aussi pour celle dont l’envie de quitter sa terre mère ne s’est pas encore manifestée.
Je ne veux pas croire en une deuxième forme de génocide par substitution comme ce fut le cas avec le Bumidom, parce que tout simplement je sais que des solutions sont possibles.
Je sais qu’aux Antilles, de meilleurs lendemains sont possibles. Cela prendra du temps peut-être, un changement de mentalité sera peut-être nécessaire, une prise de conscience sera vitale. En étant « tèt kolé », tout est possible.
Le devenir des Antilles dépend de cette intelligentsia antillaise et nul ne peut l’ignorer.