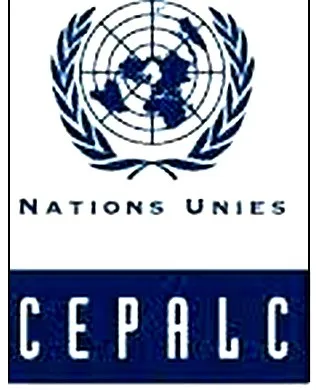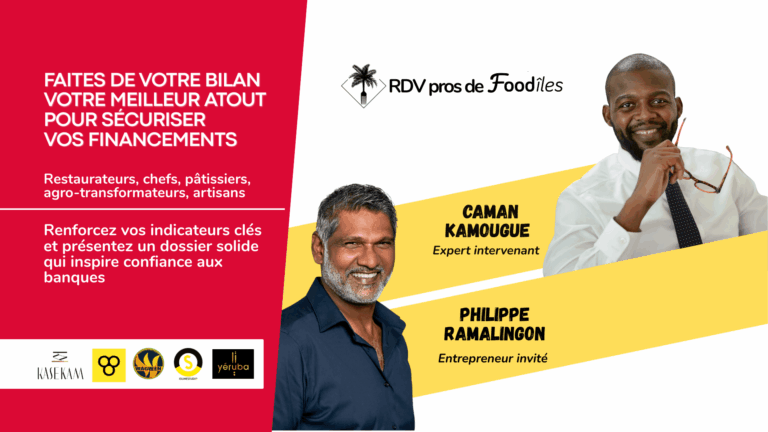Et un de plus ! Je parle bien sûr de ce billet de blog qui est le quatrième extrait de la conférence que j’ai livrée le mercredi 17 avril, sur « La place de la Guadeloupe dans la Caraïbe » au Lycée Gerville Réache à Basse-Terre.
J’ai déjà partagé trois parties :
- Parlons (plutôt) de la Grande Caraïbe
- Connaissez-vous le panaméricanisme ?
- Pourquoi la Guadeloupe, caribéenne, a des échanges commerciaux très limités avec ses voisins.
Et maintenant, il est bien temps d’évoquer la place de la Guadeloupe au sein des organisations régionales. Je commence par deux rappels importants.
« Afin de favoriser l’intégration régionale de territoires d’Outre-Mer français, les lois spécifiques à l’Outre-mer dotent les conseils généraux et régionaux d’attributions légales en matière de négociation et de signature d’accords régionaux avec les États ou les organismes régionaux voisins.
En outre, les régions d’outre-mer peuvent, avec l’accord des autorités de la République, être membres associés de certains organismes régionaux. » – IEDOM, rapport annuel économique 2022
Dans les années 2010, la Guadeloupe et la Martinique ont (enfin) manifesté la volonté affirmée d’intégrer des organisations régionales.
La Commission Economique Pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)
La CEPALC, a accepté en août 2012 la demande d’adhésion de la Martinique et de la Guadeloupe. Il a fallu l’autorisation de la France !
La CEPALC est une commission régionale de l’Organisation des Nations unies fondée en 1948. Elle travaille sur une stratégie d’industrialisation des états. La Guadeloupe participe aux réunions, mais ne vote pas.
L’Association des États de la Caraïbe (AEC)
Depuis avril 2014, la Guadeloupe et la Martinique sont intégrées à l’Association des États de la Caraïbe (AEC).
Créée en 1994, l’AEC est une organisation de consultation, de coopération et d’action concertée dans le commerce, le transport, le tourisme durable et les catastrophes naturelles dans la Grande Caraïbe. Son slogan est « promouvoir le développement durable de la Grande Caraïbe ».
Avant la Guadeloupe et la Martinique étaient représentées par la France depuis 1994 au sein de l’AEC. Sachez que c’est en décembre 2012 que la France a donné son autorisation que la Guadeloupe et la Martinique aient des sièges séparés. Maintenant, elles ont la possibilité de :
- participer, de présider des comités de travail
- voter aux réunions du Conseil des Ministres et des Comités Spéciaux sur les questions les concernant directement et relevant de leur compétence constitutionnelle.
L’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO)
Depuis mars 2019, la Guadeloupe est membre associé de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO) de plein droit. La Martinique l’est depuis 2015 !
Créée en 1981, l’OECO est une organisation intergouvernementale dédiée à l’intégration régionale. Les domaines traités : affaires économiques (agriculture, tourisme, développement des entreprises), durabilité environnementale (économie bleue), humain et social (notamment la santé).
En tant que membre associé, la Guadeloupe ne peut pas :
- adhérer au traité d’union économique
- présider l’OECO
- faire partie des institutions telles que la banque caribéenne, l’autorité de l’aviation civile.
Et la Communauté Caribéenne (Caricom) ?
Créée en 1973, la Caricom oeuvre en matière d’intégration caribéenne. Elle promeut et soutient une communauté caribéenne unifiée qui est inclusive, résiliente et compétitive, partageant la prospérité économique, sociale et culturelle. Elle repose sur quatre piliers principaux : l’intégration économique, la coordination de la politique étrangère, le développement humain et social et la sécurité.
Depuis 2012, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique sont candidates pour adhérer à la CARICOM. Pour l’heure, aucune suite favorable pour la Guadeloupe et la Guyane. Il faut une volonté politique, du lobbying !
La candidature de la Martinique a elle été acceptée et ratifiée en septembre 2023.
C’est le fruit de la volonté de Serge Letchimy, président de la Collectivité Territoriale de la Martinique, et du travail de son équipe. La Martinique deviendra membre associé en juillet 2024. Elle pourra assister aux réunions, mais n’aura pas de droit de vote. Elle ne pourra pas intégrer le Conseil des relations étrangères et communautaires.
Ah, la France…
La France a toujours été un facteur bloquant, car il faut son « autorisation » pour adhérer dans des organisations régionales, et il faut une délégation du ministère des affaires étrangères.
En plus, sa présence implique des limites.
- C’est une puissance qui entend garder la main sur la Guadeloupe, ses échanges.
- C’est une puissance qui dérange, car elle est occidentale, avec des positions diplomatiques, géopolitiques, économiques, qui ne vont pas toujours dans le sens de territoires caribéens (Venezuela, Cuba, etc).